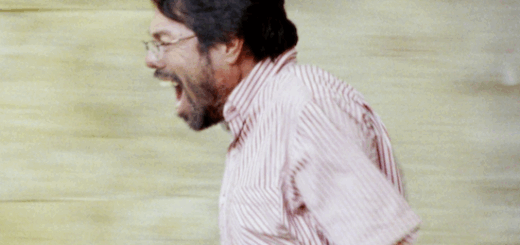Deux Procureurs (Sergueï Loznitsa, 2025)

Il ne suffit pas de se révolter au nom de la justice, il faut se déprendre, changer de paradigme
On ne peut pas détruire un système tant qu’on emploie le même langage que lui (Citation de Sergueï Loznitsa, Positif, novembre 2025).
On emploie souvent le mot « totalitarisme » pour nommer ce type de régime, mais le totalitarisme n’est pas indispensable pour se trouver enfermé dans un système clos. Choisir la période des Grandes Purges et de la Grande Terreur (1936-38) dans la Russie stalinienne, c’est prendre un cas extrême, propice à l’analyse car l’enfermement n’est pas (ou pas seulement) imposé de l’extérieur, il est aussi intérieur, vécu. Ici Kornev1, le personnage principal, par son environnement, par ses études, par sa bonne volonté même, a intériorisé et repris à son compte le discours officiel. Il n’en est pas un ennemi, mais l’un de ses représentants les plus fidèles. Ce n’est pas un hasard s’il est procureur : membre du Parti communiste, juriste, célibataire n’ayant jamais vécu en-dehors des circuits du régime, il est convaincu que ses objectifs sont les bons, que son langage est pertinent et adéquat. Les aberrations qu’il constate ne tiennent pas, selon lui, à l’essence du régime mais à des dysfonctionnements, des imperfections. C’est cette conviction très ferme qui autorise à comparer son histoire avec des situations très différentes qui mettent en jeu le même genre de mécanisme. Un libéral peut être persuadé que ce qui ne marche pas ne tient pas au libéralisme même, mais à ses lacunes, son impureté. Il en va de même pour un nationaliste, un religieux, un militant des droits de l’homme, un laïc, un trumpiste MAGA, etc. S’il croit que par essence son régime idéalisé est le bon, alors le défaut ne peut pas venir de l’intérieur, mais seulement d’une faiblesse causée par une force externe, un ennemi à dénoncer, à chasser. C’est ce qui fait l’étonnante actualité de ce film.
L’histoire est issue d’une nouvelle quasi-autobiographique de Gueorgui Demidov écrite en 1969, saisie par le KGB en 1980, restituée en 1988 et publiée en 2009, bien après sa mort (1987). Elle raconte l’aventure du jeune Kornev diplômé depuis 3 mois et probablement nommé pour remplacer un autre procureur déplacé, arrêté ou exécuté lui aussi. Demidov a passé quatorze ans au Goulag après avoir été arrêté en 1938, et le présent récit qui se terminera par l’arrestation de Kornev se situe en 1937, le pire moment des Purges, ce moment choisi aussi par Natalia Merkoulova et Alexeï Tchoupov pour leur film Le capitaine Volkonogov s’est échappé (2021), dont l’aboutissement est à la fois analogue et différent. Alors qu’en principe toutes les lettres de protestation des emprisonnés ou des condamnés étaient détruites, l’une d’entre elles (écrite en lettres de sang sur un morceau de carton froissé) arrive on ne sait comment à Kornev (peut-être, déjà, une manipulation, qui sait ?). Non sans mal, Kornev réussit à être conduit dans la cellule du détenu, un vieillard nommé Stepniak qui se trouve être un ancien dirigeant du Parti, torturé et accusé à tort, qu’il avait autrefois entendu lors d’une conférence sur la philosophie du droit. Ce Stepniak est convaincant pour Kornev car il n’a pas d’autre vocabulaire ni d’autre idéologie que celle du Parti communiste : il explique simplement que le NKVD (Commissariat du peuple aux affaires intérieures) a trahi la cause, et que le pouvoir en place démantèle les vieux idéaux auxquels il est toujours attaché. Voilà un discours qui plait à Kornev car il confirme ce qu’il savait déjà : la corruption et le caractère contre-révolutionnaire des édiles de sa région, à Briansk. À ce stade on n’est pas sorti du système. Bien que Kornev soit chargé le respect de la loi et des droits des détenus, et bien que manifestement ces droits soient bafoués, il pense toujours que la justice est du côté des autorités et qu’il suffira de les éclairer pour faire changer les choses.
Le personnage positif, sympathique, l’honnête Kornev est avant tout un rouage du système. Alors que les gardiens et le directeur de la prison ne font qu’obéir sans jamais prendre au sérieux le discours des puissants, Kornev est prêt à se sacrifier pour qu’enfin la justice prévale, une justice qui selon lui ne peut pas être dissociée de la légalité qu’il représente. Mais le pays, dans sa profondeur, fonctionne différemment. Il ne s’attaque pas frontalement au pouvoir politique, mais résiste avec passivité. Le directeur et son adjoint se moquent de Kornev. Le personnel croisé dans la prison l’observe avec mépris, se demandant s’il est plus fou que naïf. C’est également la position du procureur général Andreï Vychinski qui finit par accepter de le recevoir à Moscou et de ses agents qui l’accompagnent dans le train jusqu’à Briansk. Mis à part Kornev et Stepniak, les personnages du film ne croient pas au discours officiel. Servir le système est une chose, y croire en est une autre, et quelle que soit leur place dans la hiérarchie, les serviteurs de l’État se gardent bien de franchir la frontière – question de santé mentale.
La situation étrange dans laquelle les victimes, malgré leur détresse, leurs souffrances, sont plus abusées par le discours officiel que les officiels eux-mêmes, c’est ce qu’on nomme l’emprise. Kornev, Stepniak et le capitaine unijambiste Kopeikin qui raconte dans le train l’histoire de sa rencontre avec Lénine imaginent encore que la réalité puisse se rapprocher du discours, alors que cette hypothèse manifestement contraire à toute expérience quotidienne est rejetée par Vychinski et la hiérarchie qui lui obéit. Tout se passe comme si les personnes enfermées dans les nombreux espaces clos mis en scène dans le film (la prison, le train aller vers Moscou puis le train retour, la salle d’attente, les corridors, l’escalier, etc.) n’avaient aucun moyen d’en sortir. Il ne leur reste que l’aveu, la résistance passive ou le suicide – comme le capitaine Volkonogov – alors que d’autres prennent leurs distances, au moins mentales. Le film tire sa morale du comportement de ces personnages secondaires. Il faut, devant tout discours totalisant, se ménager un certain degré de déprise qui peut prendre des formes diverses, publiques ou secrètes. Dans ce film qui multiplie les plans fixes, les personnages sont toujours à la limite du hors-champ. La règle du cinéma selon laquelle il ne peut pas y avoir de l’extériorité au film dans le film2, puisque même le hors-champ est calculé, n’est pas applicable à la réalité soviétique. Dans Deux Procureurs, l’extériorité s’introduit par la bande : le rire jaune, l’humour décalé, le tragi-comique, le grotesque à la Gogol ou l’absurdité des situations (charger un prisonnier de faire disparaître les preuves). Les chemins de la déprise sont indirects, imprévisibles et parfois impénétrables.
- Interprété par Alexandre Kuznetsov. ↩︎
- À l’exception bien sûr de La Rose Pourpre du Caire (Woody Allen, 1985), que je ne mentionne qu’en passant. ↩︎