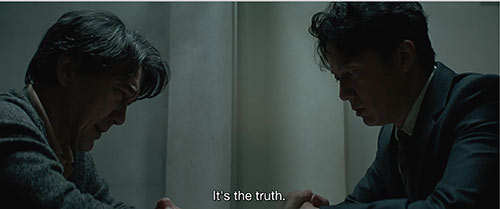La Venue de l’Avenir (Cédric Klapisch, 2025)

Nepo babies et Nepo art – Un film de retrouvailles familiales qui laisse entendre que l’art ne vaut que par sa valeur mémorielle ou marchande
L’idée de départ est assez banale : l’histoire de descendants d’une paysanne nommée Adèle Vermillard née en 1873, dont la maison normande est laissée à l’abandon depuis 1944. En 2025, ils sont une trentaine. Un promoteur veut racheter la bâtisse pour construire un centre commercial. Parmi ces arrière-petits-enfants (ou plus), quatre sont choisis pour aller sur place : Seb « créateur de contenus digitaux », Guy apiculteur écolo, Abdel professeur de français, Céline cadre dans une boîte de transport. Ils découvrent des vieux meubles, des lettres, des photographies et surtout un tableau de Claude Monet dont la valeur est, selon une experte, « inestimable ». À partir de ce canevas, Cédric Klapisch associe les deux époques dans une même histoire. On voit Adèle venir à paris en 1895, y retrouver sa mère Odette qu’elle n’avait jamais vue, constater qu’elle vit de la prostitution et que la pension dont elle a bénéficié depuis sa naissance n’a pas d’autre origine. C’est un choc, mais Adèle se remet rapidement. La mère et la fille échangent des confidences. Odette raconte qu’elle avait deux amants à l’époque, Félix Nadar et Claude Monet, sans savoir de qui Adèle est la fille. Aidée par deux jeunes amis – un photographe et un peintre eux aussi, comme par hasard -, Adèle découvre la capitale, rencontre Nadar et Monet et se rend compte que le peintre est son véritable père. La preuve : il lui offre un tableau. Elle rentre dans la ferme où elle est née pour épouser son amour d’enfance, Gaspard, illettré comme elle, et avoir trois enfants. Après avoir appris à lire, elle deviendra institutrice.
La Venue de l’Avenir, beau titre pour un film s’il était pris au sérieux, alors que de fait c’est plutôt vers le passé que vers l’avenir qu’il est tourné. Si tu connais ton passé, tu pourras mieux te diriger dit le grand-père de Seb à son petit-fils, mais cela ne se concrétise en aucune façon à l’intérieur du film, où quelques « références artistiques », comme dit le magazine Beaux-Arts, renvoient aux arts du passé : Les Nymphéas de Monet (utilisé comme décor plus qu’autre chose), Impression soleil levant du même Monet (1872), Catène de containers de Vincent Ganivet (2017), pour illustrer la chaîne généalogique, l’horloge du musée d’Orsay (pour le temps qui passe), Giverny (toujours pour les Nymphéas) et quelques photos de Nadar – la récolte est plutôt maigre et passablement conventionnelle, elle aussi. La querelle entre photographie et peinture, qui semblait intéressante au départ, ne conduit à rien. Après tout, on se moque qu’Adèle soit fille de Félix Nadar ou de Claude Monet, sauf peut-être sur le plan du portefeuille, car un tableau de Monet vaut beaucoup plus cher qu’une photographie de Nadar : preuve que la peinture triomphe sur la photographie et point de départ d’une querelle de famille sur l’usage à faire du tableau dans laquelle seule la valeur d’échange est prise en considération (faut-il ou non en faire don à l’État ?). Le tableau, pour Adèle, était un souvenir, mais pour la famille, c’est un objet à scruter aux rayons X afin d’en vérifier l’authenticité ou l’origine. Comment pourraient-ils deviner qu’ils descendent tous de Claude Monet par Adèle ? Il leur faut des expertises, des certitudes – mais aucune connaissance en art.
Dans les critiques du film parues dans les journaux ou les réseaux sociaux, la question généalogique revient indirectement, par un autre biais : la généalogie des acteurs. Les observateurs notent que huit, voire neuf acteurs sont des « nepo babies » des enfants d’acteurs et d’actrices célèbres : Adèle = Suzanne Lindon (Fille de Sandrine Kiberlain et Vincent Lindon), Seb = Abraham Wapler (Fils de Valérie Benguigui (actrice) et Éric Wapler (comédien)), Céline = Julia Piaton (Fille de Charlotte de Turckheim), Anatole = Paul Kircher (Fils d’Irène Jacob et Jérôme Kircher), Odette = Sara Giraudeau (Fille de Bernard Giraudeau et Anny Duperey), Rose = Raïka Hazanavicius (Fille de Serge Hazanavicius et Julie Mauduech), Sarah Bernhardt = Philippine Leroy-Beaulieu (Fille de Philippe Leroy-Beaulieu), Berthe Morisot = Alice Grenier-Nebout (fille de l’actrice Claire Nebout) et Lucien = Vassili Schneider (Québecois de la fratrie Schneider). Dans ce film de restitution ou de réunification familiale, ce sont les familles du milieu cinématographique qui reviennent par le biais du casting. Cette circonstance est d’autant plus intéressante qu’elle est involontaire : nous croyons Cédric Klapisch quand il dit qu’il ne l’a pas fait exprès. Adèle vient à Paris pour retrouver sa mère, tandis que de nombreux acteurs viennent au film pour retrouver la profession de leurs parents (pas tous, il faut le reconnaître, car il y a aussi Vincent Macaigne, Zinedine Soualem ou Cécile de France). Le tableau de Monet n’est pas considéré comme une œuvre, mais comme un bien de famille à transmettre. En ce sens le film est une remarquable réflexion sur ce qu’on nomme aujourd’hui l’art. Ce n’est pas une affaire de sensibilité, d’esthétique ou de culture (encore moins de sublimation), c’est une affaire de filiation, de reconnaissance. Le jeune Seb, aspirant réalisateur, capable de voyager dans le temps et de rêver de son aïeule Adèle, est un piètre artiste, médiocre producteur de clips pour Instagram. L’extrait de son travail présenté dans le film, une jolie chanteuse1 qui secoue les bras sur fond de banales vues pour touristes, aurait sa place dans le musée des horreurs – et même la chanteuse trouve ça moche. Il en résulte l’enseignement du film : l’art digne de ce nom est incompatible avec les affaires d’héritage. Dans ce film plein de références artistiques, on n’en voit pas la trace.
- Interprétée par Claire Pommet, alias Pomme. ↩︎