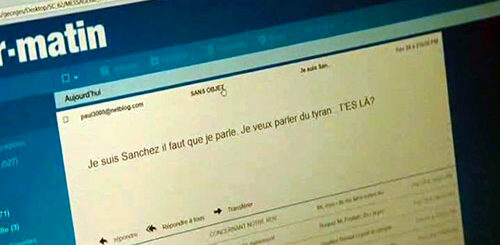Nuits blanches (Luchino Visconti, 1957), Quatre Nuits d’un Rêveur (Robert Bresson, 1971)

Il n’y a pas de justice en amour
C’est une histoire racontée d’abord par Fiodor Dostoïevski en 1848 sous le titre Les Nuits blanches : roman sentimental (souvenirs d’un rêveur) et adaptée par plusieurs cinéastes, non des moindres : Luchino Visconti (1957), Jacques Demy (1961), Robert Bresson (1971), Sanjay Leela Bhansali (2007), James Gray (2008), Paul Vecchiali (2014). Dans le texte de Dostoïevski, il n’y a pas seulement quatre nuits comme chez Bresson mais aussi un matin, c’est-à-dire un jour supplémentaire par rapport aux quatre nuits. La localisation n’est pas Paris mais Saint-Pétersbourg, pas sur les bords de Seine mais sur les bords de la Neva. La jeune femme s’appelle Nastenka et non pas Marthe, le narrateur reste anonyme au lieu d’être nommé Jacques1 comme chez Bresson, lequel a conservé l’anonymat pour le troisième personnage, le locataire, dont Marthe2 tombe instantanément amoureuse, sans rien savoir de lui. Mon analyse ayant pour point de départ le film de Bresson, je vais conserver les prénoms qu’il a choisis : Marthe et Jacques, bien que la décision de Dostoïevski de ne nommer qu’une seule personne (Nastenka devenue Natalia chez Visconti) soit incontournable. Jacques n’est pas vraiment un personnage3, c’est plutôt l’homme quelconque, celui qui incarne la vie dans sa banalité la plus courante, qui vit dans un lieu indéterminé restitué pour Visconti (dans son film) aux studios Cinecita. Pour résumer cette histoire, je n’ai pas trouvé meilleure formulation que : un amour injuste. Jacques mérite l’amour de Marthe. Il lui sauve la vie quand, par désespoir, elle décide de se suicider en se jetant dans la Seine. Il ne lui reproche rien, il l’admire et lui est fidèle. Au contraire le locataire anonyme, à l’attitude apparemment froide, sans affect, qui a promis à la jeune fille de la retrouver au bout d’un an, à cet endroit-là précis au bord du fleuve, est une singularité, une exception. C’est un étranger, un intellectuel qui lit des livres, un amateur d’opéra (ou de cinéma)4. Cet homme n’ayant pas respecté sa promesse, Marthe commence par succomber à la tendance de certaines femmes à vouloir mourir quand elles sont privées de leur objet d’amour5. « Sans lui, je ne suis rien » s’écrit-elle, comme si son propre milieu, son passé, n’avait absolument aucune valeur. Le locataire est engagé dans la société, il y a des amis, des ennemis, des projets et des enjeux, tandis que le principal point commun qui réunit Marthe et Jacques est la solitude. Ils n’ont pas de perspective, pas d’avenir, vivent sous la menace constante d’une profonde dépression. On devine les raisons pour lesquelles Marthe s’intéresse à lui, mais on comprend moins pourquoi lui, il s’intéresserait à cette jeune fille inculte et naïve de 17 ans.
Le récit renvoie à une double distinction entre conditionnel et inconditionnel. L’amour de Marthe pour le locataire est inconditionnel, ce qui ne veut pas dire qu’elle n’a pas d’amour pour Jacques, mais ce n’est pas le même genre d’amour. Dans la toute dernière lettre du dernier matin écrite par Nastienka au narrateur, on peut lire :
Je vous remercie, oui, je vous remercie de votre amour. Il est gravé dans mon esprit comme un beau rêve qu’on se rappelle longtemps après le réveil; je n’oublierai jamais l’instant où vous, m’avez si généreusement offert votre cœur en échange du mien tout meurtri. Si vous me pardonnez, j’aurai pour vous une reconnaissance presque amoureuse, à laquelle je serai fidèle.
Tout est dans le presque. Nastenka conditionne son presque-amour au pardon du narrateur. S’il pardonne, alors elle sera fidèle au quasi-amour qu’elle lui voue – mais le même mot nomme deux sentiments distincts. Entre amour conditionnel et inconditionnel, l’écart est radical, il n’y a aucune comparaison, aucune relation possible. Le premier est un échange, un équilibre entre deux soutiens, deux appuis, on pourrait dire deux prestations équivalentes fournies par deux personnes sur une base égalitaire; le second s’abolirait lui-même s’il autorisait la réciprocité, la proportion, la mesure, l’équilibre, la symétrie, l’harmonie, la rationalité. Il y a dans le film de Visconti une extraordinaire scène de danse à laquelle Natalia-Nastenka prend un immense plaisir. C’est la première fois de sa vie qu’elle danse, la première fois qu’elle rit si ouvertement, peut-être la première fois qu’elle est si heureuse, mais cela ne suffit pas. Son plaisir est une découverte, une joie procurée par le narrateur, elle ne le minore pas mais il reste soumis à un rapport d’échange. L’amour inconditionnel ne se mesure pas au plaisir procuré, il est compatible avec la déception, le désespoir, le malheur.
La dissociation entre deux types d’amour vaut aussi pour la justice. Si Marthe n’était animée que par une justice transactionnelle, conditionnelle, elle préférerait récompenser Jacques pour son soutien, car il le mérite. Mais la justice pour elle est une justesse, elle ne vaut qu’inconditionnellement. Il lui est impossible, inimaginable, de dévier de son engagement pour le locataire. Elle reconnait les deux justices comme valides tout en sachant qu’il y a entre elles incompatibilité, irréconciabilité. Se confronter à cette dissociation, c’est souvent attirer sur soi l’échec, la souffrance, le malheur. Le cinéma et plus particulièrement le mélodrame s’empare avec avidité de cette tension6. L’amour profond, archaïque, l’archi-amour ne se reconnait qu’un principe : lui-même. N’étant pas fondé sur l’échange, il est injuste par essence.
Marthe et Jacques se ressemblent. Ils se connaissent l’un l’autre en leur for intérieur, ils peuvent anticiper les avantages / inconvénients de leur union éventuelle : mise en commun des difficultés, soutien mutuel, solidarité, avec pour contrepartie la pauvreté matérielle et culturelle, un univers resserré, limité. Tout dans ce devenir est prévisible, déterminé par le passé. En croisant l’enfant abandonné et l’orpheline, on risque de fabriquer du même. Le locataire vient de l’extérieur, il est l’extériorité même. Sa venue est imprévisible, incertaine, déroutante. C’est lui qui cause l’improbable rencontre entre Marthe et Jacques, et c’est lui qui fait obstacle à leur réunion. En lui se rejoignent la liberté et l’injonction extérieure, l’ouverture aléatoire et la pression du pouvoir, l’émancipation et l’emprise. Entre les deux tendances, le rapport est variable, circonstanciel. Aucune prévalence ni hiérarchie n’est plus légitime qu’une autre.
On trouve dans Dostoïevski une dimension dont ni Visconti, ni Bresson ne rendent pleinement compte : le narrateur est un rêveur. Il ne fréquente personne, n’a pas d’amis, ne part pas à la campagne, ne vit pas, il rêve. La nouvelle a pour titre Les nuits blanches7. Quand il raconte les moments où il se laisse aller au rêve éveillé, Nastenka l’écoute « très étonnée, les yeux grands ouverts ». Le titre bressonien, Les Quatre Nuits d’un Rêveur, reprend sans le déployer le thème du rêveur solitaire, et Visconti l’ignore. En marchant dans les rues sans prêter attention à la foule qui l’entoure, l’homme est envahi par des pensées incontrôlées. « Il ne désire rien, il est au-dessus de tout désir, il peut tout, il est souverain. Il est le propre créateur de sa vie, et la recrée à chaque instant par sa propre volonté » écrit Dostoïevski, et il pleure. « Ce serait à croire, Nastenka, qu’il est amoureux! ». La rencontre avec la vraie Nastenka met fin à cette dérive imaginaire, qu’il vit comme un crime, un péché. « Maintenant, quand je suis auprès de vous, quand je vous prie, l’avenir me semble impossible, la solitude, l’absence, le vide ». La rencontre opère pour lui comme un choc de réel, un abandon de l’activité fantasmatique qui lui permettait de vivre. Le narrateur aura définitivement abandonné les rêves fous, irrationnels. Guéri de l’inconditionnel, il n’a plus d’avenir.
- Interprété par Guillaume des Forêts. ↩︎
- Interprétée par Isabelle Weingarten. ↩︎
- Dans le film de Visconti, Marcelo Mastroianni peut apparaître, jeune, comme l’Italien typique. ↩︎
- Interprété par Jean Marais, absolument hiératique dans le film de Visconti. ↩︎
- Appelons cela, par exemple, le syndrome de Didon, reine de Carthage, qui se donne la mort au départ d’Enée, le seul homme pour elle digne d’amour. ↩︎
- Exemple : Le Prince de Hombourg (Marco Bellocchio, 1997), Pandora (Albert Lewin, 1951), L’homme au crâne rasé (André Delvaux, 1965), Sur la route de Madison (Clint Eastwood, 1995), etc. ↩︎
- On peut se demander, à l’extrême, si Nastenka n’est pas une invention de sa part. ↩︎