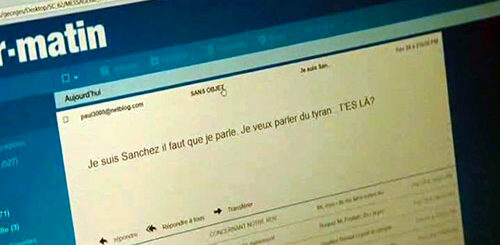Toutes les nuits (Eugène Green, 2001)

Il faut un vide pour aimer
Le film fait référence à la première Education Sentimentale de Gustave Flaubert, un roman de jeunesse écrit entre 1843 et 1845 (né en 1821, Flaubert avait 22-24 ans), et conserve les mêmes prénoms. Il y a les deux amis, Henri1et Jules2, il y a la femme mariée dont Henri tombe amoureux, Emilie Renaud3, il y a le directeur de l’école où Henri étudie, M. Renaud, mais le contenu de l’histoire est sensiblement différent. Alors que la relation entre Henri et Emilie ne se concrétise jamais chez Flaubert, Emilie tombe elle aussi amoureuse d’Henri chez Green, et le couple s’enfuit à New York. Incapables de résoudre leurs problèmes économiques, ils se disputent et reviennent en France, Henri finit ses études (brillantes), se marie avec une autre femme avec laquelle il a des enfants. Jules de son côté reste solitaire, asocial. Sur une période d’une douzaine d’années (1967-1979), la relation entre les deux amis passe par des hauts et des bas. Jusqu’ici c’est assez simple, mais Eugène Green introduit des événements perturbants, énigmatiques :
- Emilie et Jules développent une relation épistolaire intime. Ils s’aiment tendrement, mais ne se verront jamais. C’est une amitié profonde, mais sans contact charnel.
- Restée seule après sa séparation d’avec Henri, Emilie décide d’avoir un enfant, mais refuse les avances de Jules. Elle choisit Henri comme père qui devra rester inconnu, absent. Elle couche avec lui une dernière fois. Il ne saura jamais qu’une petite fille est née de cette relation.
- Henri a des remords et vient s’excuser auprès d’Emilie dans sa ferme de Normandie. Il se dit toujours amoureux, mais Emilie répond qu’elle aime le Henri d’avant, pas celui d’aujourd’hui. Elle ne lui dit rien de l’existence de sa fille.
- Au lieu d’élever elle-même sa fille, Emilie la confie à son ancien mari dont elle est divorcée. M. Renaud l’éduque selon ses propre principes (jésuites), comme il l’avait fait avec Henri (avec succès).
- Emilie reçoit un signe : un homme évadé de prison avec des stigmates sur les mains qui dit s’appeler, lui aussi, Jules. Elle comprend que Jules doit devenir le père spirituel de la fille d’Emilie.
- Sur l’ensemble de la période, Henri et Jules se voient rarement et suivent des chemins divergents. Ils échangent parfois, mais ne se soutiennent pas.
Le réalisateur introduit une série de vides, d’absences, qui peuvent sembler incompréhensibles, voire choquants : Emilie et Jules, qui s’aiment, ne se rencontrent jamais physiquement; la fille d’Emilie est abandonnée, élevée comme une orpheline par M. Renaud en n’ayant passé qu’une seule nuit avec sa mère, sans connaître le nom de son père dont seul Jules lui parlera, elle n’a pas de prénom, pas d’identité; Henri abandonne la femme qu’il aime, Emilie; Emilie subit une vie de pauvreté et de solitude dans sa ferme normande; avant Emilie, Jules pleure son premier amour, la comédienne Lucie, il renonce à ses ambitions d’écriture (son seul projet aura porté sur la mort de Rimbaud); l’amitié entre Henri et Jules est de plus en plus distancée, et finalement Jules remplace Henri. Tous ont évoqué la possibilité du bonheur ou des moments heureux à un moment ou à un autre, mais ils échouent, ils sont malheureux (comme Gustave Flaubert lui-même à la fin de sa vie). L’éducation sentimentale est une éducation à la dépossession, au manque, à la tristesse.
On n’imagine pas, dans le cours du film, qu’il se terminera par l’image de cette petite fille solitaire, quasi orpheline, élevée par un directeur d’école avec lequel elle n’a aucun lien biologique. Cette gamine dépouillée de tout n’est qu’un cas extrême d’un orphelinat généralisé. Les parents des deux amis, Henri et Jules, habitent dans le même village mais n’ont aucun rôle, et leurs rejetons se conduisent comme s’ils n’existaient pas. Le père d’Emilie est un paysan normand, mais on n’entend que sa voix, et l’on ne voit de lui que sa tombe. Le directeur d’école est solitaire, il n’a qu’Emilie qui se sépare de lui. Les personnages n’ont pas de famille, et le seul qui en crée une, Henri, le fait par ambition ou par arrivisme, hors champ du récit proprement dit. Cet effacement des généalogies contraste avec la place majeure de l’histoire dans le récit, la forte présence des églises, de la musique baroque4 et du christianisme (Emilie croyante, Jules dans un monastère). Tous les acteurs sont orphelins, nous sommes tous des orphelins. Dans ce monde sans père ni mère, que même Dieu semble avoir déserté, on ne peut échapper à l’errance.
Le film se termine par la fenêtre allumée de la chambre de l’enfant anonyme, âgée de 8 ans. Jules s’en va, il la laisse seule dans cette grande maison. Pourquoi le directeur l’a-t-il installée dans la chambre numéro 3 où Henri et Emilie ont fait l’amour pour la première fois ? Ce n’est pas l’endroit où elle a été conçue, c’est le lieu de la rencontre de deux personnes qui se trouvent être ses parents (allusion à une scène primitive qui lui est interdite). Elle ne quitte pas ce lieu, qui n’est pas pour elle un point de départ, un commencement, mais un lieu vide, un lieu d’abandon. Assignée à cette place où la vie de ses parents a basculé, peut-elle encore avoir une vie propre, un avenir ? Jules, son père de substitution, est aussi un rappel de ce passé, une fiction de parenté qui ne change rien à sa solitude. Le titre du film, Toutes les nuits, n’apporte aucune ouverture, mais au contraire l’obscurité d’une clôture. « Il faut attendre la nuit, dit Jules devant la maison de la Sauvage, parce qu’on ne peut être heureux que dans la nuit ». Emilie conclut en disant : « Il ne reste plus rien, rien ». Il reste à la fille anonyme de répondre à cette phrase et de montrer qu’à partir du Rien, on peut tout construire (l’essence de la pensée d’Eugène Green).
Il reste à se demander pourquoi le réalisateur a introduit cette machine à évider, pourquoi il a inventé cet engrenage effrayant d’abandon et d’absence. Dans cette tragédie de la destruction des possibles à laquelle même le machisme d’Henri ne résiste pas, il ne reste qu’un lieu où Emilie est venue dormir le jour où M. Renaud a financé son retour en Normandie, un espace de nostalgie où elle a pleuré, cette chambre n°3 devenue la prison d’une enfant. Or ce lieu, il aura été la chambre de l’amour. AMOUR, tel est le mot-clé. L’aboutissement de l’éducation sentimentale, c’est-à-dire de la recherche d’amour, c’est le vide. Tel est le drame de la théologie négative : en ce lieu d’origine d’où viennent les espoirs, les attentes, les signes et les décisions, personne ne répond, et pourtant, il faut aimer ce lieu. Il n’y a là rien de rationnel ou même de démontrable, mais c’est ainsi ; pour avoir la possibilité d’aimer, il nous faut un vide. Nous devons nous contenter de cette possibilité – dans l’absolue incertitude que quelque chose en advienne.
- Interprété par Alexis Loret. ↩︎
- Interprété par Adrien Michaux. ↩︎
- Interprétée par Christelle Prot. ↩︎
- Musique de Clément Jannequin. ↩︎