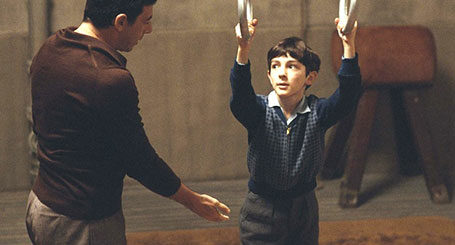Tardes de Soledad (Albert Serra, 2025)

Faire l’expérience, en quasi-direct, du réel de la mort
C’est un film qui se passe en Espagne dans une arène de corrida, qui montre un torero et le rituel qui l’entoure jusqu’à la mise à mort des taureaux. C’est son thème, son sujet, mais il ne se limite pas à ce thème, il le déborde, ou plus exactement, il le pousse tellement loin qu’il finit par s’en écarter, par dire autre chose, par en dire plus. Il ne nous parle pas de la mort des taureaux, ou des toreros, il nous parle de la mort en général. Il est rare au cinéma qu’on voie mourir, de face, un être vivant. Il y a des tentatives comme dans un autre film d’Albert Serra, La mort de Louis XIV (2016), La Jetée (Chris Marker, 1963) ou Le lion est mort ce soir (Nobuhiro Suwa, 2018), des essais documentaires comme le film de Naomi Kawase, Letter from a Yellow Cherry Blossom (2003) qui filme les derniers jours du photographe Nishii Kazuo, il y a aussi, par exemple, les différentes adaptations de la nouvelle d’Edgar Poe, La vérité sur le cas de M. Valdemar, mais dans dans tous ces cas, la mort n’est pas vécue de l’intérieur, elle n’est montrée qu’indirectement. En général, au cinéma comme en peinture, la mort est factice, elle est représentée comme l‘imaginent les stéréotypes les plus courants. On ne présente jamais la vraie mort d’un humain, mais seulement sa caricature, et cela vaut également pour l’animal : chassé ou abattu, il est transformé en dépouille, en viande, mais jamais on ne montre la mort comme telle, c’est-à-dire la mort telle qu’elle peut être éprouvée par celui qui meurt. Il se pourrait que ce film-là ait une autre ambition. Il pourrait s’agir de nous faire éprouver la mort en tant que telle, réellement, en direct – ou quasiment.
La corrida fascine car celui qui met à mort l’animal risque lui aussi de mourir. Sans ce risque, la mort du taureau n’aurait aucun sens – ce ne serait qu’un abattage, une simple boucherie. En mettant en jeu sa propre vie, le torero confère une dignité à l’acte de tuer. C’est ce don qui lui donne le droit de porter ce vêtement qui magnifie l’opposition du rose et du jaune, de la chance et de la malchance. La beauté de son geste, son élégance, ne tient pas (ou pas seulement) à sa prestance, elles tiennent à la (mince) possibilité qu’il laisse au taureau : Toi aussi, tu peux me tuer. Si le taureau se défend avec bravoure, s’il n’est pas exécuté dans les quinze minutes, la corrida s’arrête, et c’est la honte – mort symbolique du torero, fin du prestige du vainqueur, du matador, du tueur. Le taureau sauvé peut devenir reproducteur – père de futur taureaux qui finiront eux aussi dans l’abattoir ou dans l’arène.
Il y a la corrida et ce qu’on en dit généralement : sexualité omniprésente, torero alternativement viril (avec une sollicitation particulière des couilles, survalorisées mais moins visibles que celles de l’animal) et féminisé (tenue en tissu brodé de milliers de perles, corps souple pénétré par les cornes du taureau), alliance des pulsions de mort et sexuelles, risque entretenu par la relative imprévisibilité du taureau, valorisation du moment de l’agonie de l’animal, moment orgasmique où le risque de mort est partagé par les deux combattants, adaptation parfaite du geste du torero à la charge de l’animal, courage du torero, qui voit en face sa propre mort, et dont le sang se mêle à celui du taureau, etc. Et il y a l’insistance de ce film où Andrés Roca Rey, torero d’origine péruvienne âgé de 28 ans, ne joue pas un rôle mais nous fait ressentir la mort au présent, la mort en acte, assumée comme telle. « À l’heure où tuer est devenu le fait de techniques ignobles et anonymes, la force de la corrida est de s’obliger à regarder la mort en face et à en assumer pleinement la responsabilité »1. Philippe Combessie fait remarquer que le premier matador espagnol considéré comme un artiste, Juan Belmonte, et le premier matador français d’envergure internationale, Nimeño 2, sont tous deux décédés par suicide2. Leur survie aurait-elle été vécue comme un aveu d’échec ? Un texte écrit par le frère de Nimeño 2 se termine par ces mots : « la mort est offerte à ceux qui restent pour qu’ils en fassent ce qui leur convient, qu’ils la rendent regardable, rassurante, émouvante ». Il ne s’agit pas d’évoquer la mort de façon indirecte, artistique ou sublimée, mais de la donner à vivre, à travers des corps qu’on voit saigner, souffrir, mourir.
Claude Lanzmann a découvert la tauromachie grâce à Simone de Beauvoir. On peut s’interroger sur le rapport entre la passion qu’il a entretenue pour la corrida et son film Shoah. Dans l’arène, la mise à mort est montrée en direct comme un spectacle – on ne peut la voir qu’en plan large, de loin. Le public réagit collectivement, en applaudissant ou pas. Dans le film d’Albert Serra, on ne voit jamais les gradins, le combat est filmé de près, réduit à un pur duel inégal (le groupe de toreros contre le taureau solitaire). Le film nous met en présence de la mort donnée ou reçue, il nous oblige à la contempler personnellement, individuellement. Dans Shoah, le réalisateur rejette toute exposition directe et même toute archive pour s’appuyer exclusivement sur le témoignage de ceux qui ont vécu, vu l’extermination de leurs propres yeux. Ils nous parlent, et nous ne pouvons que les croire. Convoqués individuellement, nous choisissons de revivre par identification l’expérience de cette personne-là. Que nous acceptions ou que nous rejetions catégoriquement la corrida, nous éprouvons le sentiment d’un risque ultime, d’un moment de basculement. Le film témoigne de cette chose indescriptible, inexprimable qu’est la mort.
Le film insiste sur la transgression d’un interdit : voir la mort concrète, en tant que telle. Citation d’Albert Serra : « La mort du taureau, on l’a vue dans d’autres films, mais avec les cameramen nous étions obsédés par la possibilité de filmer le taureau en train de mourir »3. Quelle différence y a-t-il entre « voir la mort du taureau » et « filmer le taureau en train de mourir » ? Le taureau n’interprète pas sa mort, il ne fait pas semblant, il meurt vraiment dans la plus grande solitude (d’où le titre du film : Après-midi de solitude); et dans son mimétisme, le torero ne fait pas semblant non plus, il côtoie la mort, lui aussi dans la plus grande solitude malgré les encouragements. En enregistrant des bruits habituellement inaudibles (la respiration du taureau, les éructations du torero, ses mots), en filmant en gros plan les regards, les torsions de la bouche, le sang, le sable, la boue, les habits déchirés, en enregistrant des détails grâce à des microphones et des transmetteurs cousus dans les costumes, en faisant sentir la haine pour l’animal, Albert Serra vise une crudité, un événement impossible à sublimer ou à exalter, un « moment de grâce » qui n’arrive que très rarement, peut-être, dit-on, une seule fois dans la vie d’un torero. C’est ce moment que recherche le temps suspendu de la faena, ce temps d’extrême lenteur, ultra valorisé, où la mort guette. Pour certains gestes, les autres toreros parlent de vérité, vérité pleine. Quelle vérité ? Quelle est cette chose qui se dit pour de vrai ? Celle qui nous attend tous. Les cérémonies funéraires font entrer dans le deuil de l’autre, elles servent à faire accepter la mort d’autrui, tandis que le rituel de corrida invite à accepter sa propre mort, le deuil de soi-même, à l’exemple du taureau et du torero.
Dans une corrida, les mêmes gestes se répètent jusqu’à l’écœurement : six taureaux tués par après-midi dans le même rituel quasi-mystique, la même cruauté, la même répétition des mêmes phrases viriles d’encouragement. Que le circuit passe par Madrid, Bilbao ou Séville ne change rien. Il faut tous les jours choisir une tenue, faire le signe de croix devant la sainte Vierge, et rejoindre l’arène. Cette réitération nous affecte vers la fin du film. Ça suffit! Nous en avons assez de cette injustice, cette absurdité qu’est l’assassinat du taureau, nous aimerions que ça s’arrête. Nous sommes heureux de revenir vers cette vie dont nous n’ignorons pas qu’elle n’est que le prolongement d’une attente, d’un répit vers l’heure ultime. Pour nous qui ne sommes pas des aficionados, le temps d’un film, nous confions au torero la charge de l’angoisse, du face-à-face que nous passons notre temps à écarter, à repousser toujours plus tard, mais nous savons que nous ne sommes pas du côté du torero, mais du taureau4. Un jour ou l’autre, l’estoque s’abattra sur nous.
- « La mort n’est pas cruelle », Jean-Paul Curnier, Art Press 2, 2014, pp. 105-108 ↩︎
- Combessie Ph., “¿Viva la muerte? Thanatos mis en scène à l’ombre d’Éros”, SociologieS, 2017 ↩︎
- Cahiers du cinéma, mars 2025. ↩︎
- Il est significatif que le taureau soit tellement présent dans le film (grâce au travail de montage d’Albert Serra), mais qu’il soit entièrement absent de la bande-annonce. Il faut bien héroïser le matador pour attirer le client. ↩︎