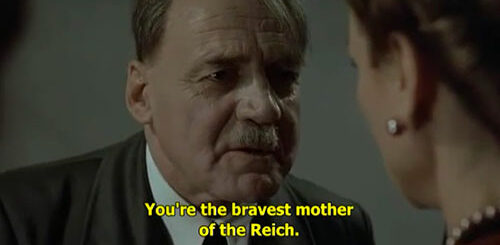Myth of Man (Jamin Winans, 2025)

Dans un monde sans parole, sans écoute, sans compassion, il n’y a plus aucun vivant pour porter un enfant
C’est un film pensé, réfléchi, conçu, écrit, produit, tourné sur une dizaine d’années (2015-2025). Chaque image, chaque vêtement, chaque effet visuel a été imaginé et réalisé par Jamin et Kiowa Winans, ce couple qui habite et travaille à Denver (Colorado). On peut dire qu’il est entièrement porté par ces deux personnes, ce qui en fait un événement autobiocinématographique (qui porte, par le cinéma, la vie de ses auteurs), puisqu’un des thèmes est justement Je te porte, phrase adressée à un enfant. Le couple porte le film comme si c’était leur enfant, et d’ailleurs c’est leur enfant. Ils ont vendu leur maison pour le financer, en ont fait un objet unique dont l’ambition réside dans le titre : Myth of Man, pas moins.
Ella1, l’héroïne du film, étant sourde-muette, on pourrait dire que c’est un film muet si la bande-son, créée par Jamin Winans (compositeur de métier) ne parlait pas à sa place. Ella n’entend rien, mais la musique que nous entendons produit sur nous un effet sensoriel, une stimulation qui pourrait ressembler à ce qu’une personne sourde perçoit par les vibrations2. Artiste de rue solitaire, elle rencontre au cours du film trois personnages : Caley l’enfant noir cleptomane et mutin, qui s’empare de tout ce qu’il peut, Seeg le barbu en colère qui doit lutter contre une tendance à la destruction, Boxback le vociférateur aux jambes paralysées et au corps bardé de micros, qui n’arrête pas de hurler ce que Ella ne peut pas entendre. Ces personnages qui, comme Ella, errent dans la rue, ne peuvent pas être assignés à une position unique : ils n’arrêtent pas de changer de point de vue, occupant toutes les places. En tant que sourde-muette, Ella ne peut pas communiquer avec les habitants de la ville qui passent devant elle sans la voir. Elle est attirée par une étoile brillante qui surgit de temps en temps dans le ciel, explose en se transformant en personnage lumineux qui lui-même produit, avec une sorte de bâton magique, tout un monde. Sur l’épaule des habitants qui marchent comme des zombies, dissociés les uns des autres, on peut voir un trait lumineux qui témoigne de leur énergie, leur santé. Quand le trait s’éteint, ils meurent. Comme nous, les spectateurs, Ella peut voir cette marque lumineuse ignorée par les habitants, qui peut à tout moment s’effacer. De temps en temps, un étrange nuage rouge se répand dans la ville et détruit tout sur son passage. Ce monde instable, qui passe sans transition d’un manque d’énergie à un excès d’énergie, n’offre aucun appui solide.
Le film commence par une scène où, dans le train de banlieue où circule Ella, un jeune garçon tombe au sol. Les voyageurs quittent le train sans s’occuper de lui. Personne ne reste pour le secourir sauf Ella qui fait ce qu’elle peut (sans succès) et peut-être Caley. À cette image initiale répond un dessin animé récurrent où l’on voit le personnage lumineux issu de l’étoile brillante s’activer. C’est lui qui anime le monde et fait vivre un enfant. Dès qu’il s’en va, l’enfant poursuivi par un monstre s’effondre au sol – comme le jeune garçon du train. Le personnage lumineux revient, il le prend délicatement dans ses bras et se retire. Dans ce film extraordinairement diffus, démultiplié, cette image animée est l’élément structurant qui revient à plusieurs reprises. Il s’agit de porter un enfant dont on n’est pas sûr qu’il ait assez d’énergie pour vivre. Ce thème revient à la fin du film, quand Ella succombera dans les bras de Seeg, à la place de l’enfant. Elle aura été portée, mais cela n’aura pas suffi pour la faire vivre. Il ne restera de ce monde qu’une série de photos projetées sur un mur qui (comme toute photo) ne représentent que des morts. Le personnage lumineux s’agenouillera tristement devant cette accumulation de souvenirs. Cette fin pessimiste, tragique, contraste avec la fin heureuse du premier long-métrage de Jamin Wimans, Ink (2009), qui montrait au contraire les retrouvailles heureuses d’une fille avec son père. Il est vrai qu’entre-temps, la situation politique des Etats-Unis ne s’est pas améliorée.
Pendant tout le film, Ella est en même temps pleine d’espoir et désespérée. Nul ne répond à cette jeune femme qui ne peut rien dire, mais seulement voir, regarder. Si le film porte une thèse sur le mythe de l’homme, comme le suggère son titre, alors cette thèse pourrait s’énoncer ainsi : L’idée d’un monde qui puisse porter les humains est caduque, ce n’est plus qu’un mythe. Avec les bras cassés qui l’accompagnent, Ella incarne la croyance inverse, elle imagine qu’on peut encore porter les humains, mais elle n’entend rien de ce monde qui l’entoure, un monde de toute façons dépourvu d’oreille où nul n’écoute son voisin. Boxback le vociférateur croit pouvoir se faire entendre en hurlant, mais ça ne marche pas, et lui aussi finit par se taire. Il semble que toute la compassion du monde se soit concentrée dans ces quatre personnages – comme si la surdité d’Ella opérait pour elle comme une enveloppe la protégeant de l’égoïsme général. Elle ne peut s’appuyer sur personne d’autre, et ses trois compagnons ne suffisent pas pour canaliser l’énergie venue d’ailleurs.
Si l’on interprète le personnage lumineux comme un Dieu créateur, alors le thème du film est l’échec de sa création. Celle-ci prend la forme d’images, de dessins, de notes de musique qui ne cessent de se disséminer sans but ni cohérence, sans organisation, sans rien qui puisse les faire tenir ensemble. Ce chaos entraîne le dédoublement d’Ella, auquel elle-même ne comprend rien. Dans sa version sombre, terrestre, dans les rues de la ville, elle n’a qu’un oeil pour voir, l’autre étant oblitéré à cause d’un excès de lumière qui jaillit de son cerveau (elle doit cacher ce phénomène qui inquiète ses interlocuteurs). Dans sa version blanche qu’on n’ose pas qualifier de céleste car en réalité jamais elle ne quitte la ville, ses deux yeux restent ouverts mais elle n’a aucune prise sur le monde. Les mains en avant, elle tente de retenir des objets qui lui échappent. Les deux Ella sont impuissantes. Elles naviguent entre le nuage rouge incendiaire et des tentatives de stabilisation toujours relancées. Ella possède une reproduction du dieu créateur en fil de fer, mais ce n’est qu’un fétiche. Il rassure parfois, mais l’effet est dérisoire, temporaire. Ella possède aussi un appareil rotatif qui simule le mouvement et un disque recouvert de symboles auxquels elle semble croire. Mais malgré ses appels, l’étoile lumineuse est incapable de restaurer la création. Au lieu de revenir et restaurer la vie de l’enfant, elle sombre dans la mer. Le compagnon Seeg tente lui aussi d’agir. Il projette des images sur un mur, souvent de belles images de solidarité ou d’amour, mais leur effet pratique est nul.
Ella n’est pas concernée par le son, mais par les images qu’elle ne cesse de vouloir faire revivre. Elle en trouve partout : qui flottent dans l’air, qui s’effacent dans les nuages, qui se dispersent par terre, qui forment des tapis volants, qui sont épinglées sur un mur, qui démolissent un immeuble, qui s’empilent sans raison, qui forment des tranchées, etc. Elle tente de présenter ces images au personnage lumineux, mais il ne fait que réitérer la même scène. Pour compléter ces tentatives, Seeg met en œuvre toutes sortes de machineries, il projette les images en couleur sur les murs, mais ça ne donne rien. Des militaires les arrêtent et les mettent en prison. Ils y retrouvent Cagey qui a récupéré le disque en le dérobant et Boxback sans sa chaise roulante (figure de la souffrance) qui perd parfois la voix. Une sorte de vent sacré les emporte dans le monde de la fuite. Seeb accroche sur Ella un appareil photographique qui projette les objets et les images sur un parapluie mobile – un moyen de dédoubler, de faire revivre les choses. De quoi espèrent-ils le retour avec ces efforts ? On n’en sait rien. Peut-être de ce qu’Ella a perdu, de la signification des symboles du disque, des désirs des personnes rencontrées au hasard, ou quoi ? Tout cela ne sert à rien, les paroles se perdent sans qu’on puisse les arrêter, une autre artiste de rue agonise, les tentatives d’Ella dans la mer des images (c’est-à-dire des spectres de personnes disparues) échouent. Après avoir fait le tour de son disque, Ella est à court d’idées. Ils partent en ville à la recherche d’une solution, à la rencontre d’autres personnes et ne trouvent qu’un signe énigmatique, d’autres images d’un passé révolu où les familles étaient heureuses. Tandis qu’ils sont fascinés par des figures de joie translucides, abstraites, artificielles et fausses, l’oreille d’Ella commence à couler. Ils se consolent les uns les autres.
Myth of Man est un film humaniste dans un monde où l’humanisme n’a pas sa place. C’est un film qui porte avec courage ce qui reste d’humain dans un lieu incapable de retenir les dernières images spectrales qui s’envolent irrémédiablement. S’il n’y a plus ni passé, ni avenir, alors le petit Cagey dont la raison de vivre était de remplir ses poches de tout ce qu’il trouvait sur son chemin, n’a plus de justification. Il ne peut plus être porté par personne. Que le plus jeune s’en aille est une tempête, un cauchemar abondamment mis en scène dans les images ultimes du film. S’il n’y a plus personne à porter, alors on n’a pas besoin non plus des porteurs, plus rien ne peut compenser la tristesse, le désespoir. Il n’y a plus d’horizon. N’imaginant pas vivre seule parmi les spectres, Ella prend place dans la file des condamnés. Elle passe devant Seeg pour que ce dernier humain, en pleurs, puisse la porter.
Pour interpréter ce film, on peut partir de la citation que retient Jacques Derrida d’un texte de Paul Celan : Die Welt ist fort, ich muss dich tragen3. Un monde a disparu, définitivement. Au-delà de la tristesse, du désespoir, des pleurs, à quoi peut-on encore s’attendre ? Trois possibilités : 1/ C’est fini, ce monde va disparaître, plus personne ne le portera. 2/ Le monde va continuer, mais rien de nouveau ne peut en émerger. 3/ Ce monde qui va continuer est improductif, mais peut-être quelque chose, autre chose, peut surgir de l’extérieur. Il reste un espoir : porter cette extériorité. On peut trouver ces trois possibilités dans le film, notamment la troisième, par le biais du personnage lumineux, que certains interprètent comme le Créateur.
- Interprétée par Laura Ranch. ↩︎
- Les critiques américains parlent de « Autonomous Sensory Meridian Response » (ASMR), ce qui renvoie à une perception directe, peu contrôlable. ↩︎
- « Le monde n’est plus, je dois te porter ». ↩︎