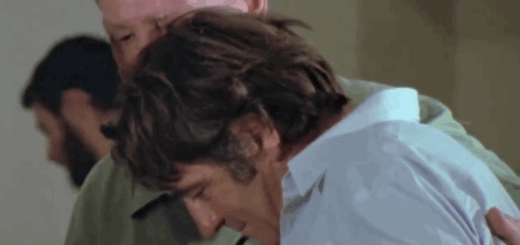Je veux juste en finir (Charlie Kaufman, 2020)

À tout ce qu’on voulait faire de moi, j’ai acquiescé, mais on ne peut pas m’empêcher de dire « je »
Le film commence par un vieil homme qui fait le ménage dans un couloir. C’est l’histoire d’une jeune femme dont le prénom varie (Lucy, Lucia ou autre) en route pour rencontrer les parents de son petit ami Jake. Il a un prénom, un seul, mais elle le connaît peu cars ils ne sont « ensemble » que depuis six semaines. Le voyage en voiture, très long, se fait sous la pluie puis sous la neige. On entend le discours intérieur de la jeune femme, tandis qu’ils discutent de choses et d’autres. Tous deux sont des scientifiques, apparemment des physiciens. Lui semble assez désespéré, et elle, elle se demande ce qu’elle fait là. Arrivés dans la ferme des parents, ils vont dans l’étable où des animaux morts jonchent le sol. D’abord la maison semble vide, puis les parents de Jake arrivent. Ils sont très bizarres, c’est une sorte de délire avec un enchaînement de séquences absurdes ou impossibles. La jeune femme essaie de mettre un peu d’ambiance pendant le repas. Puis les parents semblent brutalement vieillir de vingt ans. Lucy ne comprend plus rien et veut rentrer chez elle. Ça dure longtemps, Jake nourrit sa mère. Enfin ils prennent le chemin du retour. Nouvelle longue séquence en voiture, sous la neige. Malgré le froid, ils s’arrêtent à un marchand de glace où Jake semble connu. Il ne touche pas aux glaces, mais veut faire un détour pour les jeter. Elle ne comprend pas, elle voudrait rentrer chez elle. Le détour les conduit dans le lycée qu’il a fréquenté dans sa jeunesse, seul endroit selon lui où il y a une poubelle. Dans cette poubelle, beaucoup de glaces du même genre ont déjà été jetées, et dans le lycée, le vieil homme qui fait le ménage n’est autre que Jake à la fin de sa vie. Puis arrivent d’autres séquences, dont un aparté dansé dans le style Powell / Pressburger. On en arrive à la fin de la vie de Jake où il se présente devant une assemblée caricaturalement vieillie, où on le félicite pour son prix Nobel tandis que l’ancienne jeune femme, devenue âgée, pleure et l’applaudit.
« Je veux juste en finir », dans la bouche de la jeune femme, ça ne veut pas dire « Je veux mourir » (elle n’a aucune envie de mourir), ça veut dire : « Je veux en finir avec ce voyage cauchemardesque avec mon soi-disant boyfriend », ou bien : « Je veux rentrer chez moi ». Elle doit rentrer chez elle finir un travail, elle commence tôt le lendemain dit-elle, mais on comprend mal en quoi consiste son travail, elle est parfois serveuse, parfois peintre, parfois poète, parfois gérontologue, parfois peut-être journaliste, et parfois physicienne. Son métier est comme son nom (Lucy – Louisa – Lucia – Amy) : il est instable, indéterminé.
Pour que ce film soit possible, il aura fallu que la jeune femme ne soit pas vraiment fixée, il aura fallu donner une consistance à l’interprétation selon laquelle elle n’est qu’une projection des fantasmes de Jake. Dans un rêve ou un fantasme, tous les voyages et toutes les transitions sont imaginables : dans l’espace sur une route sans visibilité, dans le temps avec des personnages qui changent d’âge et d’apparence, et aussi dans le cinéma, dans la littérature, dans la poésie, etc. Ces moments ne sont pas ordonnés ni successifs : comme dans l’inconscient, ils peuvent se juxtaposer, se surimprimer, coexister dans la même scène. Les destins de Jake coexistent eux aussi : il peut finir balayeur, homme de ménage de son ancien lycée chargé des poubelles, ou scientifique reconnu, adulé par ses pairs. Dans les deux cas c’est émouvant, à en pleurer, et dans les deux cas il reste attaché au lycée où il conduit la jeune femme, ce lieu où il a pu prendre ses distances avec ses parents, se soustraire à sa famille de paysans dont il a honte. Mais avoir honte ne l’empêche pas d’acquiescer, et avoir honte ne l’empêche pas non plus de ressentir pour eux une certaine tendresse, un amour certain.
Quant à la jeune femme qui n’a pas de nom ou qui en a trop, la question qui lui revient sans cesse à l’esprit est celle du consentement. Comment a-t-elle accepté de venir là sans le moindre désir, sans en avoir aucune envie? Elle a acquiescé, et immédiatement après avoir acquiescé (voire même avant) elle a regretté, elle s’est reniée. C’est un film sur l’acquiescement, le consentement, la décision. C’est toujours l’autre qui décide, et la jeune femme est la marionnette de ces desiderata (même les plus absurdes). La décision ici n’est pas un moment précis, un instant, c’est un continu. Ça ne cesse de décider pour elle de la manière la plus arbitraire, même si elle aimerait en finir. Jusqu’à la dernière scène, elle s’inscrit, sans sortie possible, dans la fantasmagorie de Jake. Que la femme puisse être indépendante est inconcevable, n’y pensez pas.
A la fin du film elle a l’air de s’être réconciliée avec lui et peut-être aussi avec elle-même, elle a vraiment consenti, elle est émue, elle applaudit tandis qu’il chante sa chanson. Elle a tellement consenti qu’il ne reste plus rien d’elle, c’est fini, elle n’a plus rien à consentir.
La jeune femme est une marionnette qui ne fait que reproduire les opinions des autres : Pauline Kael sur le film de Cassavetes Une femme sous influence, le poème Bonedog de Eva H.D. dont elle prétend qu’elle l’a elle-même écrit et qui se trouve déjà dans la bibliothèque de Jake, les peintures de Ralph Albert Blakelock, un autre schizophrène qui finira sa vie dans des institutions psychiatriques, peintures qu’elle a téléchargées sur son téléphone, et même le récit de son enfance dans une ferme qui n’est qu’une imitation de la jeunesse de Jake, alors qu’elle dit par ailleurs qu’elle a été élevée dans un appartement. Son personnage n’est rien d’autre qu’une projection du paysage mental de Charlie Kaufman scénariste – comme Susan dans Adaptation, Clementine dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Adele, Claire et Hazel dans Synecdoche, New York. Elle s’approprie les idées et les livres du jeune Jake dont les archives sont conservées dans sa chambre d’adolescent, elle se remémore les souvenirs du vieux Jake qui regarde en boucle, à la télévision, l’héroïne d’un film de Robert Zemeckis (un faux film, inventé par Charlie Kaufman), son visage étant projeté dans la voiture à la place de celui de l’actrice. Même le titre du film, I’m thinking of ending things, traduit en français par Je veux juste en finir, est ambigu. Il est possible que ce soit une expression soufflée par le vieux Jake sur le point de mettre fin à une existence ratée, mais il est aussi possible que cette phrase soit bien à elle, et qu’elle renvoie à ce jeu de citations dont elle voudrait se débarrasser pour enfin penser par elle-même, dire « je ».
La jeune femme qui semble consentir à tout n’est en réalité consentante de rien, comme elle le dit vers la fin en dénonçant par avance un viol dans les paroles de la chanson Baby It’s Cold Outside et en répétant sans cesse qu’elle veut partir. Alors qu’elle n’est pas réelle, qu’elle condense les figures plus ou moins fabriquées des (nombreuses) filles que Jake n’aura jamais osé aborder, elle résiste. Dans cet univers mouvant, confus, labyrinthique, où plus rien ne semble avoir de sens, où de nouveaux éléments s’agrègent jusqu’au point où il faut renoncer à la compréhension, lâcher prise, la jeune femme n’a pas de substance, elle n’est qu’un dispositif, un assemblage de citations qu’elle répète sans mentionner les auteurs, du début (les premières pages du livre de 2016 de Ian Reid dont Kaufman propose une adaptation) à la fin. Mais elle n’est pas la seule : Jake aussi répète des phrases déjà dites, de la réplique phare de la pop culture (« Winter is coming! ») vers le début du film aux paroles d’une chanson de la comédie musicale Oklahoma! vers la fin du film. Tout cela laisse entendre que, peut-être, nous les spectateurs ne sommes pas très différents, nous aussi nous réagissons à partir des citations que nous avons engrangées pendant toute notre vie.
L’un des nombreux Jake, celui qui est supposé avoir réussi sa vie, s’est dégagé de sa famille pathogène par le consentement à l’étude. Le lycée lui aurait permis de prendre ses distances à l’égard de la prison psychique parentale. Mais ces parents qu’il méprise, dont il a honte, restent à l’horizon. A peine a-t-il eu une « petite amie » qu’il la leur a présentée (réellement ou fantasmatiquement). À ces parents proches du fantasme, il a présenté une « petite amie » qui n’est pas véritablement sa « petite amie », qui est peut-être elle aussi un fantasme. Et ce personnage qui n’existe pas, inspiré par un autre roman (Neige d’Anna Kavan) est quand même le personnage principal du film. C’est cette capacité à échapper, malgré tout, à l’esprit de Jake, à se dégager de ces constructions closes et même peut-être aussi à l’esprit envahissant du réalisateur (en anglais director), qui rend ce film énigmatiquement vrai.
La question posée est celle de la fabrique du je. Tout est emprunté, et rien au départ ne lui est « propre ». Tout se passe comme si elle n’avait pas besoin du propre pour construire le propre. Il y a ce qui se présente comme une pensée consciente et ne l’est pas encore, mais pourrait le devenir. La jeune femme n’est plus un bébé depuis longtemps ni même une petite fille, mais ce qui se joue est ce point de basculement, le moment où elle va prendre consistance comme personne en se détachant des identifications qui l’ont constituée. Dans la scène finale, elle pleure encore au souvenir de ce passé, l’émotion est toujours là, mais c’est bel et bien à la mort de Jake qu’elle applaudit. D’ailleurs le film ne se termine pas tout de suite : un nuage bleu envahit l’image, puis on voit, un instant, la voiture couverte de neige devant le lycée. L’autre monde, le monde de la future femme, commence hors film, dans le flou de cette image-souvenir qui, en silence, sert de fond au générique de fin.