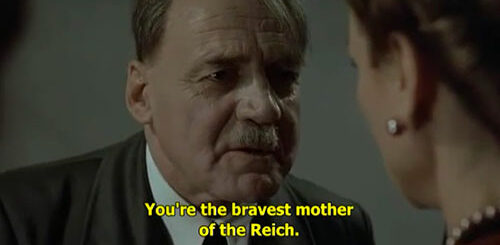Le Voyage de Morvern Callar (Lynne Ramsay, 2002)

Une appropriation posthume au service d’un énigmatique désir féminin
Elle s’appelle Morvern Callar1, c’est son vrai nom et elle le répète souvent. Elle a 21 ans, est vendeuse de supermarché dans un petit port sur la côte ouest de l’Ecosse. Morvern est un prénom plutôt rare (il faut qu’elle l’épelle : M. O. R. V. …), typiquement écossais, qui provient d’une péninsule des Highlands, loin vers le nord. La racine gaélique pourrait signifier, dit-on, grande brèche, ce qui renvoie à la sauvagerie des paysages locaux et aussi à une certaine brisure pour cette fille dont la mère adoptive est morte il y a peu, et qui ne semble pas avoir d’autre famille. Son patronyme, Callar, signifie « se taire » en espagnol. Son copain James dit Jacky ne devait pas être beaucoup plus heureux, puisqu’il se suicide. Elle reste longuement couchée le long de son corps, le caresse, puis se dirige vers l’ordinateur allumé. « READ ME » écrit-il, puis « Sorry Morvern. Don’t try to understand, it just felt like the right thing to do. My novel is on the disk, print it out and send it to the first Publisher on this list, if they will not take it try the next one down. I wrote it for you. I love you. Be brave. »2 C’est un lâchage et aussi un testament, un abandon et aussi une injonction, un suicide et aussi un programme pour l’avenir. Elle hésite, sort pour téléphoner, mais change d’avis. C’est le moment de la décision, une décision absolument unique, singulière. Le jour de Noël, Jacky lui a fait le cadeau ambigu de sa mort et aussi d’une belle veste en cuir adaptée au climat, d’un briquet, d’une cassette de musique « pour elle », précise-t-il. Elle ne pleure pas, elle prend un bain, se maquille, se peint les ongles, prend un billet dans la poche de Jacky, lui dit « Sorry », puis elle se rend au rendez-vous qu’elle avait avec sa copine Lanna Phimister pour la fête du soir. Elle excuse Jacky. De toute la fête elle ne dit rien à personne, et c’est seulement le lendemain, après son retour qu’elle lit la suite du texte sur l’ordinateur. « I left money in the bank for the funeral, the card is in the draper, you know the code. Keep the music for yourself.3 » Elle ouvre la pièce jointe, qui commence par : « A NOVEL BY James Gillespie ». Elle regarde plusieurs fois la phrase I WROTE IT FOR YOU, puis remplace le nom de James Gillespie par le sien : Morvern Callar. Au lieu de lire le livre, de se positionner comme lectrice, elle interprète la phrase en prenant la place de l’auteur, du propriétaire. De son point de vue, s’il a écrit pour elle, c’est que ça lui appartient. C’est le début de l’appropriation posthume. Pendant qu’elle nettoie le sol et efface les traces visibles du cadavre, on entend l’imprimante. Elle ne prend pas la peine de lire le texte mais le place dans une enveloppe. Puis elle passe à la banque, tire de l’argent sur le compte du mort (qui n’est pas officiellement mort), envoie le roman à l’éditeur, et réserve des vacances en Espagne pour elle et sa copine.
Tout est dit, et le reste du film compte peu. Pour Morvern, le don de Jackie ne concerne pas le roman comme contenu, mais comme objet. On ne saura jamais ce qu’il avait à dire, ni dans quelle mesure la jeune femme y est impliquée. Tout se passe comme si Jackie n’était pas vraiment mort, mais simplement parti sur un coup de tête, comme le croient Lanna et les autres copains. Puisqu’il n’est pas mort, elle n’est pas endeuillée, elle peut jouir sans culpabilité de ce qu’il lui a offert : son roman, sa musique, ses affaires, sa mémoire. Elle se débarrasse du cadavre à la façon dont on fait les courses ou le ménage, sans émotion. Jamais elle n’annoncera son décès, sauf une fois à son amie Lanna qui ne la croit pas, ne la prend pas au sérieux. Ce qui pour elle fait office de deuil, c’est son départ de l’Ecosse, son entame d’une nouvelle vie avec les 100.000 £ d’à-valoir dont l’éditeur lui fera cadeau pour payer le roman. Elle transforme le don qu’on lui a fait en richesse matérielle, sans compassion apparente, sur la base d’un raisonnement économique. Elle ne procède pas par identification, mais par pillage, sans marquer aucun intérêt pour le texte, qu’elle ne lit pas. Plus tard les éditeurs ne s’offusqueront pas de son comportement un peu bizarre, de son mutisme, car ils la prendront pour une artiste – originale par essence.
Tiré d’un roman4, le film réussit à rendre sympathique ce personnage qui ne cesse de jouer sur l’ambiguïté : pas très séduisante mais sexy, jouisseuse mais calculatrice, cynique mais généreuse, banale mais prenant une décision inimaginable, presque inconcevable. Il fascine par l’étrange capacité d’une jeune femme à transgresser les interdits les plus courants sans jamais perdre son calme ni sa placidité. Après tout son droit au plaisir est inaliénable, et si elle en a les moyens personne ne peut l’en empêcher. Elle entame en Espagne des vacances tout ce qu’il y a de plus britanniques, avec plage, baignades, boîtes de nuit et coucheries, quand elle tombe sur un garçon qui vient de perdre sa mère. Il semble triste, presque désespéré, mais lui aussi fait le choix d’un jeu sexuel impudique et joyeux – avant que Morven mette brutalement fin à leur séjour sans chercher à expliquer son geste à Lanna, et les lance toutes deux dans un improbable road-movie.
La psychologie de Morvern est difficile à reconstituer. Elle peut vouloir noyer sa tristesse dans le plaisir. Elle peut se venger de Jacky pour l’avoir abandonnée (une sorte de divorce posthume). Elle peut se sentir coupable dans ses moments de silence et de solitude. Elle peut cyniquement profiter de l’occasion sans jamais se poser aucune question éthique. Elle peut se dire qu’après tout elle ne fait qu’obéir à ce qu’il lui suggérait, en lui disant qu’il a écrit pour elle. Rien dans le film ne permet de trancher entre ces hypothèses, et il pourrait y en avoir d’autres. On peut comprendre ses décisions, mais on peut aussi la condamner sévèrement. À l’extraordinaire preuve de confiance que lui a fait Jackie, elle répond par une brutale destruction de sa mémoire. Au don qu’il lui a adressé, elle répond par une appropriation intéressée, un mensonge impardonnable à l’égard de l’homme qui l’a aimée. Au devoir de deuil, elle répond par le pouvoir exercé sur un mort. Elle rejette par pur égoïsme l’altérité de l’homme, son héritage dont seuls les éditeurs appréhenderont le contenu – même le titre du roman nous est dissimulé. On pourrait répondre qu’il n’y a pas de mal puisqu’il est mort. Mais justement, un mort n’a pas de défense, pas de répartie possible. L’histoire de Morvern Callar montre que rien n’empêche de tromper un mort, le trahir. On peut aussi le posséder intégralement.
Ce film réalisé par une femme est souvent revendiqué par d’autres femmes. Par son étrangeté et le mépris qu’il manifeste à l’égard des règles de la société masculine, il a un côté féministe – comparable au Wanda de Barbara Loden (1970). Ce n’est pas pour rien s’il commence par la mort du compagnon, la saisie de ses biens matériels. Le film enveloppe ce geste dans une esthétique visuelle et des choix musicaux envahissants, sensuels, mesmériques (le Velvet Underground, Nancy Sinatra et Lee Hazelwood). Il ne s’excuse pas, mais atténue la violence du geste par des sonorités qui prolongent la présence de Jackie. Morvern esquisse une société où les hommes sont instrumentalisés, mi-phalliques mi-cadavériques. On peut coucher avec eux, à condition de les laisser tomber le lendemain. Pour qu’elle prenne confiance en elle-même, affirme son autonomie tout en restant jusqu’au bout énigmatique, mystérieuse, il fallait effacer la puissance masculine, en gommer la créativité. Le résultat est une curieuse combinaison de déprise (se dissocier d’un monde qu’elle n’a jamais ressenti comme sien) et d’emprise (s’emparer du travail d’autrui, en profiter). Le meurtre s’ajoute au suicide, pour le neutraliser.
- Interprétée par Samantha Morton, qui a effectivement passé une partie de son enfance dans des familles d’accueil. ↩︎
- « Désolé Morvern. N’essaie pas de comprendre, j’ai juste eu l’impression que c’était la bonne chose à faire. Mon roman est sur le disque, imprime le et envoie-le au premier éditeur sur la liste, s’ils ne le prennent pas essaie le suivant. Je l’ai écrit pour toi. Je t’aime. Sois brave ». ↩︎
- « J’ai laissé de l’argent à la banque pour l’enterrement, ma carte est dans le tiroir, tu connais le code. Garde la musique pour toi ». ↩︎
- Issu d’un roman de même titre d’Alan Warner (1996). Ce livre a eu beaucoup de succès, il est considéré lui-même comme un « livre-culte ». ↩︎