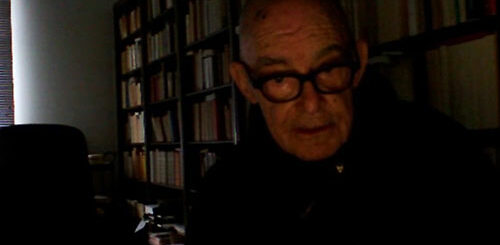Hérédité (Ari Aster, 2018)

La famille décapitée, le père impuissant, la société inopérante, il appartient au fils de prendre en charge la souveraineté d’un monde à l’avenir inconnu
C’est un film qu’il faut voir, entendre et interpréter dans son contexte politique : la première élection de Donald Trump le 8 novembre 2016. Le président a été intronisé le 20 janvier 2017, le tournage a commencé en février 2017 dans l’Utah, le film est sorti le 21 janvier 2018 au festival de Sundance. Bien que le film ait été entièrement conçu avant cette élection, ces dates doivent être gardées en mémoire car elles constituent elles aussi l’hérédité du film, le passé immédiat dont il doit rendre compte, à la façon du fils Peter qui devra, à la fin, rendre compte de la souveraineté qui lui échoit. Ari Aster, né le 15 juillet 1986 à New York, a réalisé The Strange Thing About the Johnsons en 2010. Dans ce film de thèse, il mettait déjà en scène un jeune homme dominant son père. En 2017, il avait 30 ans. Comment prendre la suite des cinéastes qu’il admirait (De Palma, Polanski, Bergman, Haneke, Fellini, etc.) ? La question posée dans ce premier long métrage est celle du fils, Peter. Avec un père psychiatre (Steve) et une mère artiste (Annie), il pouvait imaginer tous les avenirs, mais finalement c’est la généalogie de sa mère qui s’est imposée à lui : la matriarche Elen, morte à l’âge de 78 ans à la suite, dit-on, d’une longue maladie (mais peut-être d’autre chose). Avec son père Steve Graham dont on ne devine presque rien si ce n’est son esprit scientifique et méthodique et sa jeune soeur Charlie (13 ans), visiblement dérangée, ils vivent dans une grande maison assez glaciale, qui ressemble aux maisons de poupée fabriquées par sa mère, maquettiste.
L’histoire commence par une décapitation involontaire effectuée, justement, par Peter. Il s’en sent responsable mais, de fait, ce n’est pas sa faute, car c’est sa mère qui l’a forcé à amener avec lui à une party d’adolescents la petite Charlie qui n’en avait aucune envie. Elle mange un gâteau aux noisettes auxquelles elle est allergique, elle a une crise, Peter se précipite pour la conduire à l’hôpital, elle étouffe, elle sort la tête par le fenêtre de la voiture, et pan! Elle heurte un poteau de bois et la voici décapitée. C’est fini pour Charlie; la mère se sent responsable de la catastrophe (à juste titre), elle voudrait se suicider. Deux morts l’une après l’autre, sa mère et sa fille, deux raisons de remuer de très mauvais souvenirs, deux deuils. Pour le premier (sa mère), Annie s’était rendue à un groupe de parole où elle avait raconté sa triste histoire : une mère abusive qui l’a forcée à avoir des enfants alors qu’elle n’en voulait pas, un frère psychotique mort prématurément. La généalogie des femmes se met en place : on comprend que la mère pratiquait des séances de spiritisme, qu’elle a laissé des traces de cette activité que sa fille n’a jamais voulu voir, que la mort désespérante de Charlie n’est pas due totalement au hasard. L’héritage passe par les femmes, mais c’est Peter, et lui seul, qui en est l’héritier.
Je vais tenter d’analyser ce film à partir d’une séquence qui ne dure que quelques dizaines de secondes. Charlie s’exprimait peu, mais dessinait. Elle a laissé un carnet de dessin où elle représente son père, sa mère, son environnement. Annie se rend compte que ce carnet, inspiré par la grand-mère, est maléfique. Il est le moyen par lequel le spectre de Charlie (qui s’appuie désormais sur le spectre d’Ellen) fait retour et se venge. Elle décide de le jeter au feu, mais ce geste ne fait qu’attiser la malédiction (son bras s’enflamme – une preuve supplémentaire qu’elle a vu juste). Elle ne peut pas s’en débarrasser elle-même mais sa conviction ne change pas. Il faut faire brûler ce carnet. Annie supplie Steve de le faire. Le mari ne veut pas entretenir cette superstition, il pense que sa femme délire, qu’elle est malade. Il n’obéit pas à son injonction. Alors Annie s’empare du cahier et le jette dans la cheminée. Qu’est-ce qui arrive ? Ce n’est pas elle qui est punie, c’est lui. La magie opère. Le corps de Steve s’enflamme d’un seul coup, il finit carbonisé. Annie avait compris qu’elle-même étant contaminée par la malédiction, il fallait l’action d’une force pure, non infectée, pour l’arrêter. Seul Steve, porteur de la rationalité, représentant du monde de la logique ordinaire, pouvait s’opposer à la généalogie maternelle. Désormais c’est terminé, le chef de famille n’est plus là. Avec son corps et sa pensée réflexive, c’est le logos qui est éliminé. La suite arrive rapidement : après Charlie, décapitée dans un accident de voiture, Après Peter, qui s’est cassé le nez dans un geste violent d’autodestruction, Steve est réduit en cendres, et c’est Annie, pendue au plafond du grenier, qui se tranche la tête. La décapitation est générale et de toute la famille, seul Peter est toujours vivant. Rien n’empêche le spectateur que nous sommes de généraliser : héritier d’une généalogie horrifique dont on ne lui a jamais parlé, privé d’explication rationnelle, de toute possibilité d’action logique, le jeune homme vulnérable, symboliquement castré, doit se débrouiller seul. Peter n’est qu’un symbole ou une allégorie de ce qui arrive aujourd’hui : tout individu vivant à l’époque du trumpisme, premier ou second mandat (y compris Ari Aster et y compris toi, cher spectateur) doit trouver une réponse à une situation de ce genre, agir sans aucun critère sûr de choix ni de décision. Le film est actuel, et aussi prémonitoire. On n’est pas prêt d’en avoir fini avec ce type de positionnement.
Qu’est-ce qu’un récit de formation, d’initiation aujourd’hui ? Comme on le voit dans le film, le Bildungsroman ne repose pas sur des enseignants, des maîtres, mais des spectres. L’initiation est spectrale. Du début à la fin, les autorités traditionnelles sont réduites à néant. La police est inexistante, le professeur de lycée est inaudible. Le père, seule personne sensible au principe de réalité, périt carbonisé. Peter, prédestiné à devenir le grand maître, n’est que l’instrument de puissances magiques héritées d’ancêtres inconnus (ou plutôt inconnues, car ce sont des femmes) qui agissent de l’extérieur. Le héros adolescent suit une lumière dont il ne connaît pas la signification. Il finira comme roi couronné sans l’avoir voulu, sans savoir ce qui lui est arrivé. Il sera le seul à ne pas être décapité, mais au fond cela n’a pas d’importance, car il n’a pas de tête – juste un regard qui prend acte de ce qui arrive avec stupéfaction. Les traces spectrales triomphent.
Annie, la mère, porte des puissances de vie incapables d’accomplir leur mission. Elle incarne le pharmakon : à la fois protectrice et tentatrice, aimante et haïssante. C’est elle qui oblige Peter à emmener sa petite sœur Charlie à une soirée dont elle ne reviendra pas. C’est elle qui découvre avec terreur les méfaits de Joan, une amie et complice. Elle voudrait protéger son fils de ces méfaits, mais la relation sado-maso dans laquelle elle est engagée n’aboutit qu’à l’initier au culte maléfique. Elle est l’instrument de transmissions qui la dépassent, tandis que le père, hésitant, ne transmet rien. Dans la généalogie maternelle, le deuil ne se fait jamais, il est toujours interrompu. La grand-mère Ellen revient par son amie et substitut, Joan. Charlie reste présente par l’intermédiaire de son cahier de dessins et par le bruit singulier qu’elle fait en claquant sa langue contre son palais. La schizophrénie du frère disparu d’Annie s’empare de toute la maison, et Annie elle-même n’est que l’instrument désespéré de cette revenance spectrale. La généalogie de Steve, porteur du nom Graham, est complètement effacée. Le fils Peter, devenu le messie de la lignée maternelle, ne peut trouver aucun modèle auquel s’identifier. Du point de vue du père, il est sacrifié, et du point de vue de la mère, c’est une divinité retrouvée (un antéchrist). Steve, nouveau Joseph, n’est rien d’autre que le corps à travers lequel le démon Paimon aura engrossé sa femme Annie. Pendant ce temps Peter ne comprend rien, il ne fait que suivre la lumière.
La cabane, à l’extérieur de la maison, est le lieu de la transmission. C’est là que vont dormir la petite fille et la mère avant d’être décapitées. On accède à ce temple de l’extériorité par une échelle qui ressemble à celle qui permet, depuis l’intérieur de la maison, d’accéder au grenier. Dans les deux cas, l’ascension délivre de l’autorité du père. Le film a pour enjeu la destruction de la verticalité. Steve est un être phallique, qui reste toujours droit, y compris au moment où son corps prend feu. C’est le seul élément solide de l’histoire. Il finira par être emporté. Dans cette maison de poupées où s’agitent des marionnettes sans conscience morale, l’irrationnel arrive au pouvoir. Garçon sans expérience manipulé par des spectres d’un autre âge, Peter est incapable de distinguer le rêve du réel. Après la désagrégation, le délitement de sa famille, Die Welt ist fort le monde s’est effacé, il est parti dans sa totalité. Des personnages sans tête ni idée sont prosternés devant lui. Y a-t-il une force, un organisateur derrière tout cela ? On peut en douter. S’agit-il vraiment d’un combat gagné par la grand-mère ? Peut-être pas. Peut-être ne s’agit-il que d’une conjonction d’événements, qui ont (chacun) contribué à ouvrir un autre chemin.